Du birth plan du Royaume-Uni au projet de naissance en France : toute l’histoire !

Après 20 ans de parcours, on peut conclure que les espoirs portés par le projet de naissance en France n’ont pas eu les effets souhaités
Tout semble démarrer officiellement en 1988 : une Charte des droits de la parturiente, restée à l’état de projet mais parue cependant dans le Journal officiel des Communautés européennes, disait : « [...] il est dans l’intérêt, aussi bien de la femme que de la société en général, de résoudre les problèmes relatifs à la grossesse et à l’accouchement, et de fournir à la femme une information complète et appropriée, qui lui permette de prendre ses propres décisions dans toutes les situations auxquelles elle est confrontée. » C’est comme si soudain, après l’avènement de la péridurale comme graal de la prise en charge de la douleur, on réalisait que ça ne faisait pas tout.
Les années 1990 et le Birth Plan au Royaume-Uni
« En 1991, au Royaume-Uni, s’est ouverte la commission de recherche sur les services de maternité. Cette commission parlementaire permanente se réunit tous les dix ans. Cette année-là, les usagers et les associations professionnelles ont été invités à donner leur avis sur la façon dont les services de maternité répondaient aux besoins des usagers. L’ensemble des personnes consultées (plus de 400 rapports) ont contribué à établir un tableau assez homogène des besoins non satisfaits des parents.
Ce rapport fut suivi en 1992 de l’avis du comité d’experts Changing Childbirth. Dès 1993, la pratique des « plans de naissance » (Birth plan) devenait courante. Objectif : « Les femmes devraient avoir la possibilité de discuter leurs intentions en ce qui concerne l’accouchement et la naissance. Leurs décisions devraient être inscrites sur le plan de naissance et incorporées au dossier médical. Tout doit être fait, dans la mesure du possible, pour respecter les souhaits de la femme et de son compagnon, et pour les informer des services auxquels ils ont droit. »
Les futurs parents étaient systématiquement encouragés à consigner leurs vœux par écrit. Mais une dérive est apparue lorsque certaines structures médicales se sont mises à soumettre un formulaire type avec des cases à cocher. Le document, n’étant plus rédigé par les parents mais par le corps médical, a largement dérivé vers une demande d’accord préalable sans consentement éclairé, alors qu’il devrait être le résultat d’un processus de négociation (comme on le verra plus loin).

Au Royaume-Uni, l’étude « Est-ce que les plans de naissance affectent négativement l’issue du travail ? » a montré que, statistiquement, les femmes qui ont signifié des refus d’actes dans leurs plans de naissance subissent plus d’actes médicaux. Les auteurs ont expliqué que les équipes médicales étaient beaucoup moins disposées à les écouter et plutôt enclines à leur prouver que leurs choix conduisaient à un échec. J’espère que nous ne tomberons pas dans cet écueil avec les projets de naissance en France, et qu’à l’instar de certaines structures qui essaient de promouvoir un « accouchement à la carte », les patients pourront recevoir des fiches d’information, avec des pistes de réflexion et des encouragements sur leurs compétences d’« acteurs » de la naissance. »
(Cet extrait est issu du livre : La naissance autrement. Réaliser son projet de naissance, Sophie Lavois, Éd. Jouvence, 2006, 2009, 2014. Pages 18-20).
Les années 2000 et le Projet de naissance en France
Aux débuts de l’Internet, avant l’arrivée de Facebook, Instagram et YouTube, les intéressés, les militants et représentants associatifs discutaient sur YahooGroupes où tout se faisait par email sur une liste de discussion appelée Liste-Naissance. Et forts de ce que l’on avait constaté au Royaume-Uni, nous avons pensé que traduire birth plan par « projet » de naissance était plus judicieux que « plan » de naissance, pour justement éviter la diffusion massive de listes avec de cases à cocher (ce qui devient malheureusement de plus en plus répandu en 2023, sans parler des projets de naissance type que souhaite mettre en place le CNGOF dans le cadre d’un label qualité. Bref). La notion de projet incluait une démarche active, une exploration en conscience des possibles, des choix et droits, avant de poser un « plan » et enfin et surtout de clarifier le contrat de soins (jusqu’alors tacite). Et puis, il faut le savoir, les débuts n’ont pas été tout rose. Le projet de naissance a commencé par un scandale en France.

Christèle et Christophe Perrard avaient fait un projet-plan de naissance pour accueillir leur deuxième enfant (Calvados, France) et l’avaient présenté à l’équipe médicale, laquelle n’a pas du tout bien réagi. Et on a pu lire en direct leurs réactions sur leur forum Gynélist qui était public ! Ils discutaient avec mépris sur leur liste de discussion de professionnels de santé comme s’ils étaient entre soi. Et avant que cet espace ne soit privatisé suite à cette boulette, les usagers l’avaient déjà médiatisé. J’avais tout recopié sur mon site web de l’époque, mais ayant reçu des menaces, ces dialogues ont ensuite été hébergé sur un site européen. L’échange musclé a aussi été relayé dans le journal Génésis n°55 en avril 2000, puis dans La Gazette, trimestriel de l'association Femmes/Sages-Femmes. Les parents ont alors pris conscience de l’ampleur de cette logique abusive de la prise en otage du corps des femmes : le médecin sait, la patiente se tait.
En 2003, la Mission périnatalité, effectuée à la demande de J.F. Mattéi, prévoit, au chapitre 2, de *permettre à la femme d’élaborer un projet de suivi de grossesse et de naissance* mais en réalité les politiques jouent sur la sémantique des mots. ⚠️👉 { permettre à la femme ? VS la femme se permet ! Vous voyez la différence d’expression ? } Leur projet réel est la fermeture des petites maternités (initiée en 1998) et créer des usines spécialisées en trois niveaux selon le risque obstétrical estimé, afin d’aiguiller les femmes enceintes vers des filières de soins spécifiques. 🤫🤐 On leur fait miroiter qu’elles auront le choix de leur projet, mais elles auront surtout le choix de se conformer !
« Le caractère à « haut risque » ou à « bas risque » obstétrical peut se repérer au début puis en cours de grossesse, permettant aux patientes à bas risque de choisir un mode de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement sans l’intervention de techniques de surveillance non nécessaires. Ce mode de prise en charge, devrait concerner la grande majorité de la population. C’est ainsi qu’une information éclairée sur l’offre de soins périnatals sera donnée à la patiente, lui permettant, en toute connaissance de cause, de définir le type de prise en charge qu’elle souhaite, de choisir entre secteur public ou libéral, de se confier au personnel médical qu’elle choisit par affinité. De cette façon elle pourra établir un véritable projet de suivi de grossesse et d’accouchement. Lors de l’élaboration du projet, sera discutée l’organisation de la préparation à la naissance. Au total les femmes doivent être informées sur l’offre de soins pour donner leur consentement et leurs choix doivent être respectés. » { cette dernière phrase est perverse car si l’offre est réduite, voire unique, où est le choix réel ? Il ne s’agit en RIEN de projet de naissance au sens où on l’entendait, mais de faire miroiter un choix illusoire ! }

En 2004, le Plan périnatalité 2005-2007, remis par le Ministre de la Santé et de la Protection sociale Philippe Douste-Blazy précise : « Un entretien individuel et/ou en couple sera systématiquement proposé à toutes les femmes enceintes, aux futurs parents, au cours du 4e mois, afin de préparer avec eux les meilleures conditions possibles de la venue au monde de leur enfant. Cet entretien aura pour objectif de favoriser l’expression de leurs attentes, de leurs besoins, de leur projet, de leur donner les informations utiles sur les ressources de proximité dont ils peuvent disposer pour le mener à bien et de créer des liens sécurisants, notamment avec les partenaires du réseau périnatal les plus appropriés. »
En 2005, les recommandations pour les professionnels de santé publiées par la Haute Autorité de santé sous le titre « Comment mieux informer les femmes enceintes ? » enfoncent le clou : « L’information a pour objectifs de favoriser la participation active de la femme enceinte et de lui permettre de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Pour la femme et son entourage, le début de la grossesse est un moment idéal pour :
élaborer un projet de suivi de grossesse et de naissance. Ce projet est la conjonction entre les aspirations de la femme ou du couple et l’offre de soins locale. Il inclut l’organisation des soins avec le suivi médical et la préparation à la naissance, les modalités d’accouchement, les possibilités de suivi pendant la période postnatale, y compris les conditions d’un retour précoce à domicile, le recours en cas de difficultés ; (…) Pour les professionnels de santé, la grossesse représente une opportunité d’ouvrir un dialogue avec les futurs parents afin : de discuter du projet de suivi de grossesse et de naissance, élaboré par le couple, et dans lequel s’inscrivent les actions des professionnels de santé (…) »
Les années 2010 à aujourd'hui : le plan de naissance
L’idée d’une visite supplémentaire au 4e mois fait son chemin et c’est seulement en 2016 qu’est inclus un nouvel alinéa à l’article L2122-1 du Code de la santé publique : « (…) Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse. »

En 2020, la formulation changera : « Le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l'existence de l'entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. L'entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L'objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d'évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse. »
Enfin, en 2022, un nouvel aliéna sera ajouté au profit d’une autre visite supplémentaire en post-partum (pour prévenir et accompagner les dépressions, éviter les suicides). Mais dans les faits, cette visite du 4e mois {EPP} est surtout un entretien médico-psycho-social plus qu’un espace de questionnement individuel sur les possibles choix et droits en matière d’enfantement ou autres alternatives à l’hypermédicalisation. Comme je le disais en mai 2023 dernier sur les réseaux sociaux du blog projet de naissance :
❌❤️🩹💊 Ils ont mis les femmes dans un parcours de soins industriel, et maintenant ils réfléchissent à leur bientraitance. Mais ils sont complètement démunis pour apporter des réponses ou conditions de naissance autres que celles conçues dans leur logique de marchandisation, de gestion, de sécurisation sur la base d’une science qui présuppose l’accouchement potentiellement dangereux voire mortel. 🧠👨🏻⚕️🩺 Incapables de penser l’événement autrement, mais surtout de laisser penser les intéressées, ils n’ont rien d’autre à proposer qu’un plan de naissance type, comme label qualité, ou une énième visite médicale.
Selon l’enquête périnatale de 2021, seules 36% des femmes en bénéficieraient vraiment. Quoiqu’il en soit, un projet de naissance ne se fait pas en 45 minutes d’entretien ! Je ne suis pas la seule à proposer aux femmes de (re)penser l’accompagnement et l’information de manière holistique sur tout le temps de la grossesse. Cette idée ne date pas d’aujourd’hui, et c’est d’ailleurs ce qui se fait déjà dans le cadre de « l’accompagnement global » que proposent certaines sages-femmes. Mais maintenant que le « projet de naissance » est devenu dans la transmission populaire et médicale un plan, une check-list à cocher, un enjeu de consentement-non-éclairé … la question est : comment redonner sa consistance à cet outil d’empowerment pour des femmes en pleine conscience ? J’ai quelques idées. On reste en contact ? 😉

À propos

Hello 👋 Je suis Sophie Lavois, et j'ai créé ce blog. J'accompagne les femmes enceintes sur la voie de leur émancipation grâce au Projet de Naissance🗽

Le livre
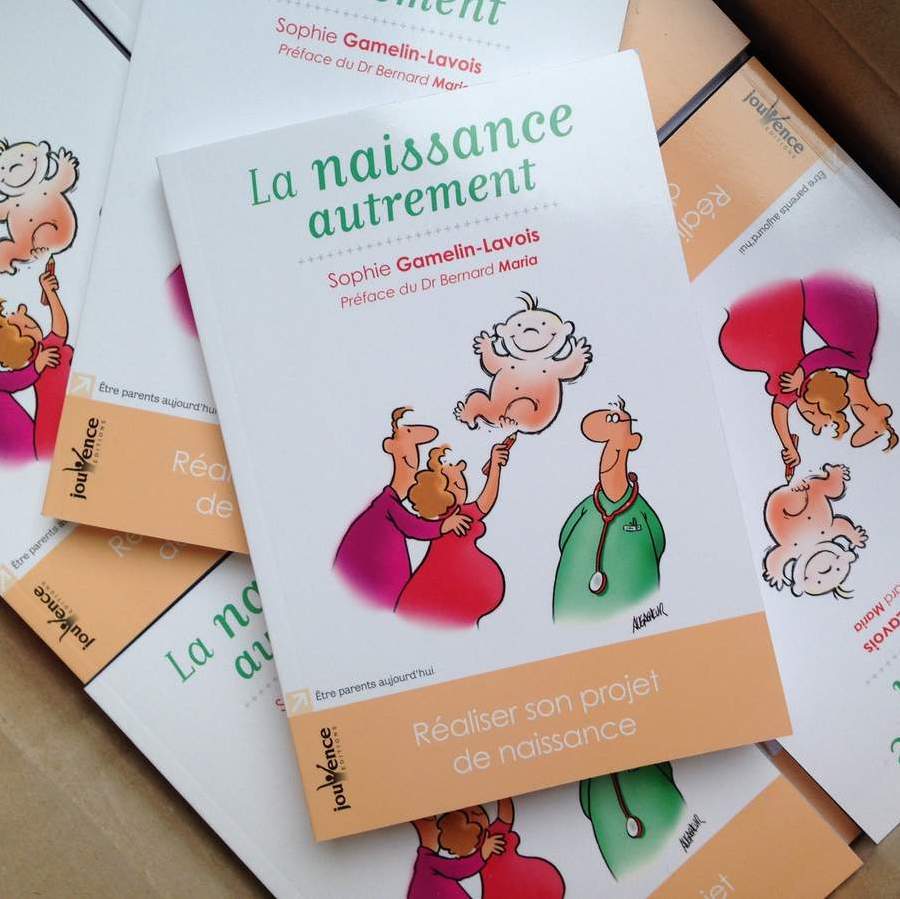
La naissance autrement est le livre de référence sur le projet de naissance en France depuis 2006 🏆














